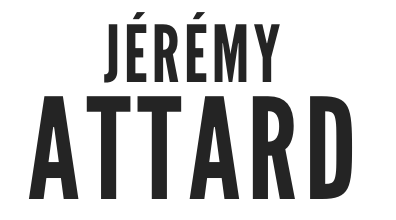Physique théorique, philosophie des sciences et épistémologie
Bonjour et bienvenue sur mon site !
Comme son nom l’indique, je m’appelle Jérémy Attard et je suis, au départ, physicien théoricien. Après avoir intégré en 2010 le département de physique de l’École Normale Supérieure de Cachan (aujourd’hui renommée ENS Paris-Saclay) et ce pendant trois ans, j’ai ensuite poursuivi mon cursus en master 2 de physique théorique et mathématique à l’Université d’Aix-Marseille (AMU), puis en thèse de doctorat au sein du Centre de Physique Théorique (toujours à AMU), que j’ai soutenue en 2018.
Pendant cette thèse, j’ai découvert le champ de la pensée critique à travers une formation doctorale transversale, ce qui a ravivé chez moi une passion pour l’épistémologie et la philosophie des sciences qui sommeillait depuis le début de mon parcours universitaire et que je n’avais que partiellement satisfaite en lisant quelques ouvrages à droite à gauche pour nourrir ma curiosité.
Après ma thèse, et comme j’aime bien aller au bout des choses, j’ai alors suivi une année de master 2 en philosophie des sciences au département ALLSH à AMU, avant de commencer une deuxième thèse de doctorat en 2020 en philosophie des sciences et épistémologie en cotutelle entre les universités de Mons et de Namur, en Belgique. Je donne aussi depuis la fin de ma thèse de physique de nombreuses formations, enseignements et ateliers d’introduction à la pensée critique et à l’épistémologie, pour des publics très variés allant des doctorants aux élèves du secondaire, en passant par des conférences grand public ou à des interventions auprès d’associations, tout cela au sein du collectif CORTECS.
Pendant ma thèse de physique, que j’ai réalisée sous la direction de Serge Lazzarini et de Thierry Masson au centre de physique théorique (CPT), à Marseille, mon travail tournait autour de différentes formulations mathématiques des théories de jauge, qui constituent le cadre dans lequel sont formulées les théories physiques les plus fondamentales.
Mon travail de thèse en philosophie des sciences, réalisé sous la direction d’Anne Staquet (UMONS) et de Dominique Lambert et Olivier Sartenaer (UNAMUR), se situe quant à lui à l’intersection de deux problèmes épistémologiques majeurs. D’une part, le problème de la démarcation scientifique, c’est-à-dire la recherche d’une démarcation claire entre ce qui serait scientifique d’un coté, et ce qui ne serait pas scientifique (ou qui serait pseudo scientifique) de l’autre. En d’autres termes, la recherche d’une définition de la scientificité, c’est-à-dire du caractère scientifique d’un énoncé, d’une théorie ou d’un modèle. D’autre part, le problème de l’unité épistémologique des sciences, à savoir : peut-on comprendre toutes les disciplines scientifiques au sein du même paradigme épistémologique, malgré leur grande diversité d’objets, d’approches empiriques et de productions théoriques ? En d’autres termes : peut-on définir la scientificité de telle façon à ce qu’on puisse en déduire des critères épistémologiques qui s’appliquent aux productions des différentes disciplines indépendamment de leur spécificité ? Je travaille en particulier sur la physique, bien sûr, mais également sur les sciences sociales, et notamment sur l’approche dite analytique en sociologie.
En septembre 2025, j’ai commencé un contrat postdoctoral de 18 mois en épistémologie des systèmes complexes, à AMU, au sein de la « chaire d’excellence » Transdisciplinarity and Complexity Research.
Thèse de physique théorique
Conformal gauge theories, Cartan geometry and transitivie Lie algebroids
Thèse de philosophie des sciences
Vers un modèle unitaire de la scientificité
Article Cortecs
Qu’est-ce qu’un bon concept ?